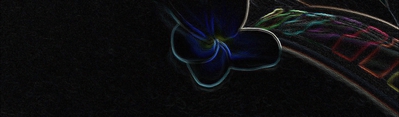http://aphanese.viabloga.com/news/lot-novembre lien vers les photos
Romain
Alain s’est approché de nous en souriant, un verre à la main. Il l’a posé sur le trottoir, le temps d’extirper une cigarette du paquet qu’il gardait dans la poche intérieure de son costume. Il a demandé à Luis s’il avait du feu. Luis a sorti son briquet.
— Tu en veux une, au fait ?
Non, Luis avait assez fumé cette nuit, il fallait qu’il se calme question tabac.
Alain a repris son verre et a tiré une bouffée en se retournant pour admirer la noce dans le café.
— Beau mariage et belle fête. Ils sont super beaux tous les deux.
Il a levé son verre à Jeannot qui a levé le sien de l’autre côté de la vitrine, à l’intérieur. Jeannot était un peu rouge, les mèches de cheveux collés de sueur, la cravate défaite mais hilare. Oui, c’était une belle fête. Jeannot nous a rejoints en titubant légèrement, s’est planté les jambes et les bras écartés, sa face offerte aux rares étoiles de Paris et a gonflé bruyamment ses poumons en s’exclamant « un peu d’air frais ! ». Luis l’a mis en garde, trempé comme il était il allait attraper la crève.
Parler de crève a fait resurgir la question qu’on se posait tous, Romain aurait pu trouver mieux comme coin pour faire la fête. Le café était au poil, mais le quartier…
Nous avons levé les yeux vers la haute paroi grumeleuse du mur du Père-Lachaise qui courait sur le trottoir d’en face dans la lumière phosphorescente des rares lampadaires. Derrière, en ce milieu de nuit, le cimetière était un bloc de silence, un trou noir dans la ville. On devinait le frissonnement des arbres enfermés dans son obscurité. C’était un spectre qui nous observait sans bouger. De l’autre côté de ce mur, noyés dans les ténèbres, des christs en croix et des vierges Marie qui veillaient, en solitude, et des pleurs gravés dans le marbre et forgés sur des grilles rouillées battues par les siècles.
La nuit, la vraie.
Je me suis ébroué. Alain et Jeannot se sont fait un clin d’œil.
— C’est vrai que le quartier est plutôt mort.
— Et la Rue du Repos, c’est plutôt le repos éternel que le repos du guerrier.
L’avantage quand on a bu, c’est qu’il n’en faut pas beaucoup pour être mort de rire.
Luis s’est fait plus sérieux. Qu’est-ce qui avait pris à Romain de choisir cet endroit ? Il tenait de Manu que Romain avait insisté pour que cela soit ici qu’on fête leur mariage. Ici et pas ailleurs. Emmanuelle n’avait pas su dire pourquoi, mais puisque Romain y tenait tant elle n’avait pas insisté. Le café était sympa, le quartier tranquille, elle n’allait pas commencer les épousailles par une engueulade pour une broutille. Mais on était tous d’accord, une fête de mariage devant un cimetière, il fallait oser !
J’y suis allé de mon témoignage puisque c’était, précisément, cette question que j’avais posée à Romain le jour précédent. Il avait esquivé avec des banalités et des boutades, comme d’habitude quand il cherche à noyer le poisson : il aimait bien ce café, il connaissait le patron qui lui avait fait un prix, pour ceux qui rentreraient tard c’était pas loin du périph et des grandes places de Paris, on ne risquait pas de réveiller les voisins…
Cette dernière remarque a provoqué de nouveaux éclats de rire. Qui se sont terminés en accès de toux pour Alain. Jeannot lui a tapoté le dos en exagérant le côté grand frère, la mort c’était Alain qui allait l’attraper s’il continuait de fumer comme un pompier.
— Aller, je rentre au chaud. Vous venez ?
On s’est faufilé entre les groupes de fumeurs qui papotaient en tenue de soirée sur le trottoir sans prêter attention à l’obscurité du cimetière, ramassée sur elle-même, qui leur faisait face.
Le petit orchestre faisait une pause, remplacé par un disque de salsa. Emmanuelle, courte robe blanche et couronne de fleurs des champs, m’a vu entrer. Elle a abandonné son petit groupe d’invités et est venue me prendre par la main. J’étais le seul à ne pas l’avoir encore fait danser, il fallait corriger ça tout de suite, je n’y échapperai pas, je devais lui montrer mon savoir-faire de salsero, hop-hop-hop, il n’y avait pas à refuser, c’était son mariage. Romain, assis avec ses parents, nous a regardés en souriant, le nœud pap’ délacé, et m’a fait un clin d’œil.
Cela faisait dix ans que je le connaissais. Romain Ecrivain. Ecrivain, c’est son nom. C’est ce nom qui m’avait intrigué quand je l’avais rencontré, la première fois. Je ne connaissais alors personne qui portât ce nom, et aujourd’hui encore, à ma connaissance, il est le seul, avec Emmanuelle bien sûr, à s’appeler ainsi. On était en fac d’Histoire tous les deux et le maitre de conférence avait fait l’appel des présents à ce premier TD portant sur l’histoire contemporaine. Tout le monde avait tourné la tête pour voir lequel d’entre nous portait un tel nom. Une épaisse touffe de cheveux noirs sauvages plus ou moins bien domestiqués en arrière encadrant un front étroit sous lequel brûlaient les charbons incandescents de deux yeux sombres. Une peau mate, un nez droit et fort au-dessus d’une bouche charnue mais avec retenue. Sans lui ressembler vraiment, il avait un je-ne-sais-quoi de Missak Manouchian.
Romain Ecrivain. Un nom comme une carte de visite. Un nom étrange qui reliait l’Antiquité avec le monde des lettres modernes. J’avais joué avec ce nom en rêvassant pendant le cours. Il ne s’appelait pas Romain Auteur, ce qui l’aurait ancré définitivement dans l’antiquité des auteurs grecs et latins. Il ne s’appelait pas non plus Romain Romancier, ce qui l’aurait relié par des assonances au 19e siècle. Non, il s’appelait Romain Ecrivain. Un nom comme un pont entre le passé et le présent.
A la fin du TD je m’étais approché et, stupidement, je l’avais félicité pour son nom. Amusé, il m’avait répondu qu’il n’y était pour rien et m’avait tendu la main.
Nous étions devenus amis. J’aimais les lettres et lui aussi, et cette passion commune nous liait comme deux fieffés complices. Combien de nuits avons-nous passées devant une bière à explorer, commenter de manière pointilleuse, les auteurs qui nous semblaient les plus novateurs ! Il avait des opinions tranchées sur tous les écrivains, surtout sur ceux qu’il aimait (Romain Gary/Ajar, l’humour du désespoir) et ceux qu’il détestait (Céline, un salaud, rien à dire de plus).
Contrairement à nous tous qui faisions profession de râler sur nos « vieux » et de les moquer sans arrêt, Romain n’était pas bavard sur sa famille. Il était même d’une discrétion jalouse. Il connaissait mes parents, je ne connaissais pas les siens. Respectant sa réserve, je n’osais le questionner à leur sujet.
Après le tronc commun du cursus nous avions divergé de centre d’intérêt. Je m’étais lancé dans une thèse de doctorat sur les rapports, parfois conflictuels, entre Sénat et Assemblée Nationale dans la 5e République sous Mitterrand. Romain, lui, s’était jeté avec une sorte de frénésie dans l’étude de la montée du nazisme pendant la République de Weimar. C’est à l’occasion de sa soutenance de thèse, que j’avais rencontré ses parents, sa sœur et une de ses grand-mères, la seule survivante de sa génération. Des gens dignes et simples, attentifs l’un pour l’autre comme des membres d’une tribu.
Deux jours plus tard, Romain était parti pour un long périple d’études en Allemagne, il y était resté et je ne l’avais plus revu.
Jusqu’à ce jour d’il y a deux ans où je l’avais croisé devant le monument aux morts parisiens de la première guerre mondiale, un long mur bornant tout un côté du Père-Lachaise et portant sur toute sa longueur une large plaque d’acier noir sur lequel sont gravés 93.000 noms de ceux de Paris qui sont morts aux combats. J’étais heureux de le voir de nouveau, mais surpris de le voir chercher à la lettre S plutôt que E.
Je m’étais approché, sourire aux lèvres. Il s’était retourné et son visage avait pris une expression de crainte comme s’il avait été en faute. Mais ça n’avait pas duré, il s’était vite ressaisi et, comme si nous nous étions quittés la veille seulement, il m’avait montré la longue plaque, tu as vu, tous bien rangés par ordre alphabétique, classés par année, qu’ils n’aillent surtout pas se perdre. Tu ne trouves pas étonnant comme on aime mettre de l’ordre après, après qu’on a bouleversé par le tumulte et la rage les hommes, les villes, les champs, après qu’on a ravagé des pays entiers ? Cherche-t-on vraiment à nous faire croire que les armées et la guerre sont synonymes d’ordre et de paix comme semblent le dire ces monuments et les cimetières militaires, alors qu’ils sont leur exact contraire ? Regarde bien ce mur, les morts n’y récolteront jamais aucune gloire, pour eux, c’est toujours trop tard. Je retrouvais là son caractère entier.
Mais quelques années avaient passées depuis la fac, j’étais devenu un chercheur en Histoire, et un chercheur ça pose des questions, ça enquête. Alors là, devant ce monument, devant les noms de tous ces sacrifiés, j’avais trouvé l’audace de le questionner. Qui cherchait-il devant la lettre S ? Il avait hésité, avait haussé les épaules. Et puis, comme il s’apprêtait à s’éloigner, il avait changé d’avis et m’avait brusquement fait face. Schreiber, m’a-t-il dit en prononçant à l’allemande, mon arrière-grand-père. Ses yeux étaient devenus de durs basaltes noirs comme il me faisait cette confidence. Il était mort fin 1919 des suites de son empoisonnement au gaz moutarde dans les tranchées. La guerre avait continué de tuer bien après la fin des combats.
Schreiber, Ecrivain ; c’est là que j’avais compris que son nom n’était que la traduction française de son nom d’origine. Mais quelle origine était-ce là : alsacienne, allemande, yiddish? A cette époque de guerre totale avec l’Allemagne avoir un nom à consonance allemande en France pouvait être dangereux, et pourtant son aïeul le portait toujours en 1919. Quand donc la famille avait-elle changé de nom ? Avant, pendant, après la seconde guerre mondiale ? C’étaient ces questions qui m’étaient venues à l’esprit ce jour-là, face à lui, après cette révélation. Mais j’avais entrouvert une porte, je n’allais pas courir le risque qu’il me la claque au nez. Alors je n’avais pas poussé plus loin, il fallait d’abord que nos liens se renouent pleinement. Et puis, d’où me venait cette curiosité indiscrète ? Ça n’était pas avec sa famille que j’avais tissé des liens d’amitié mais avec lui. Alors qu’avais-je à faire de tout ce mystère ? Mais justement, pourquoi un tel mystère ? Sa parentèle était constituée de gens dignes, qu’y avait-il donc à cacher, qu’y avait-il de si honteux ? Je n’en suis pas fier mais tout ce secret m’agaçait depuis la fac comme s’il s’agissait de sa part d’une coquetterie, et là, en cette rencontre inattendue devant ce monument, cet agacement avait ressurgi avec une force qui m’avait stupéfié. Mieux valait prendre mon temps et du recul, ne pas me jeter dans l’absurdité d’une enquête sur un sujet qui ne me regardait pas. Je devais à Romain ce respect-là.
A la fin de la salsa, Emmanuelle m’a remercié, essoufflée et ravie. Nous sommes restés près du bar qui courait sur un côté du café. Il n’y a pas beaucoup de membres de ta famille, lui ai-je dit, ils n’ont pas pu venir ? C’est pourtant un jour à marquer d’une pierre blanche. J’avais appris à l’occasion de ce mariage, sur le faire-part, qu’elle s’appelait Schmitt, Emmanuelle Schmitt, d’où j’avais supposé qu’une partie de sa famille pouvait se trouver outre-Rhin. Elle a semblé indisposée par ma question. Allons bon, encore une indiscrétion, me suis-je dit, tu es décidément incorrigible. Elle m’a regardé, et a fini par sourire. Ses grands-parents, et elle leur donnait raison, avaient rompu tout lien avec le reste de sa famille allemande avant de venir s’installer en France au début des années cinquante. On choisit ses amis on ne choisit pas sa famille, m’a-t-elle rappelé, mais on peut choisir de la renier. Romain est alors apparu et, en la saluant très bas, lui a demandé si elle voulait bien lui faire la joie d’accepter cette danse. Elle a fait une gracieuse révérence en pinçant les côtés de sa robe blanche et s’est éloignée avec lui sur la piste de danse improvisée du café.
Luis est passé me donner un petit coup d’épaule, c’est le moment, une de perdue dix de retrouvées, Hélène t’a quitté mais te laisse pas abattre c’est maintenant l’occasion de trouver une nouvelle copine, il n’y a pas mieux pour ça qu’une fête de mariage. Devant mon air peu convaincu, il m’a poussé vers la piste, aller bouge-toi, crois-tu que c’est elles qui vont venir te chercher ?
J’ai dansé sur quelques chansons de Bernard Lavilliers. Quand les trois musiciens de l’orchestre ont repris leurs instruments pour lancer une série de rocks traditionnels je me suis retrouvé devant une jolie blonde de 30-35 ans. Je lui ai tendu la main qu’elle a prise sans hésiter. Je ne suis pas trop mauvais en rock, mais je me suis appliqué. Emmanuelle, dans les bras de Romain, tournoyant un moment à côté de nous, m’a lancé joyeusement occupe-toi bien de ma cousine.
A suivre…
Marc B
Cap Blanc
Octobre 2022
Aspidistras et turpitudes.
Dans le quartier où nous habitions la ville était plate. Plate pour aller au marché, plate pour aller au lycée, plate pour aller acheter le journal, le pain, les courses de tous les jours. Plate pour aller chez la couturière, à la librairie, chez mes cousins, au jardin public. Plate pour aller chez Mademoiselle Klein qui perdait la vue, lui lire le programme de la radio pour l’aider à choisir les émissions qu’elle écouterait la semaine suivante. Plate pour la vie ordinaire. Plate et claire. Boulevards, avenues bordés de grands arbres. En plein centre un large trottoir planté de tilleuls et de platanes le long d’une grande place sablée. A midi certains de nos pères y retrouvaient leurs amis, le journal sous le bras ils se saluaient, discutaient fort et formaient deux rangées face à face. Ils arpentaient le trottoir 6 ou 7 de front, faisant la conversation en marchant ainsi, une rangée avançait, l’autre reculait. Arrivés au bout du trottoir ils repartaient dans l’autre sens. A midi 20 ils s’envolaient chacun dans une direction, parfois suivis d’un de leurs enfants. Ils couraient. Midi trente à la maison !
Le jeudi la ville était haute. On ne disait jamais que la ville des autres jours était basse ou plate, mais de la ville sombre et ancienne on disait qu’elle était haute. On disait la haute ville et non pas la vieille ville. Au sortir de petites places toutes les rues plates et claires, changeaient de nom, devenaient sombres et il fallait grimper. Parfois les rues étaient des escaliers pavés de pierres polies. Polies par les pas, avait dit mon père. Aller dans la haute ville était une excursion. Il ne fallait pas porter certaines sortes de chaussures « pour ne pas se tordre les pieds » ! On prenait la rue Saulnerie vieille, puis une rue en escalier, au milieu de laquelle une rampe en acier guidait les pas hasardeux. Un jour nous avons vu le grand frère de Jacques descendre cette rue sur son scooter. Pas un brin de soleil en débouchant en haut de l’escalier mais une enfilade de rues sans trottoir où de grandes maisons raides encourageaient à se taire. On marchait vite. Rue du Cardinal de Polignac on ralentissait pour passer devant le portail de l’évêché, on passait devant 3 ou 4 maisons toutes noires devant lesquelles des volets de bois entrouverts laissaient apparaître, dans de grands pots, des plantes vertes que je trouvais belles : des aspidistras.
Juste après on était arrivé. On vérifiait la vitrine d’un coup d’œil rapide. L’été la porte était ouverte. La vendeuse nous reconnaissait. Elle nous servait sans nous demander ce qu’on voulait. On donnait notre argent. Juste le compte. On emportait nos délices servis dans un sac en papier très fin qui se perçait dès qu’on le tenait. Sortis on grimpait en courant l’Escalier Boiteux tout noir, les pierres glissaient, suintaient, sentaient mauvais. On arrivait place du For pour s’asseoir sur le banc au pied de la croix y manger lentement nos chaussons aux pommes, le dos tourné au paysage, les yeux fixant le clocher. Silencieux. Puis on grimpait sur le socle de la croix et plongeait le regard dans les jardins de l’évêché. Je n’ai jamais dit aux autres que je rêvais de voir les chaussettes de l’évêque de cette couleur si étonnante qu’on appelle cardinale.
Le dimanche la ville devenait d’abord une côte puis une colline, une couronne de monts qui avaient tous un nom. Tous les quartiers extérieurs se trouvaient sur des rochers au pied desquels coulaient de fines rigoles qui amenaient les eaux du Dolaizon vers le lavoir derrière la rue du « Vent l’emporte ».
Le jeudi suivant Jacques nous apprit que son grand frère s’était fait sonner les cloches par leurs parents pour avoir descendu cette rue-escalier en scooter et aussi pour être allé au bout de la rue du Cardinal de Polignac. Ils avaient crié très fort et reproché à leur fils d’être allé y faire des turpitudes. Ce mot me plaisait beaucoup. Il renforçait incompréhension et étonnement. Qu’y avait-il dans ces maisons sombres aux volets entr’ouverts outre les touffes d’aspidistras gigantesques et si fournies ? On pouvait y voir parfois des silhouettes de femmes souvent assises, légèrement vêtues.
Il arrivait lors des grandes vacances d’été que j’aille avec ma mère acheter d’autres chaussons aux pommes ; nous allions aussi les manger place du For. Je lui avais demandé ce que font ces dames assises derrière les volets entr’ouverts. Elles attendent, avait-elle répondu. On avait aussi parlé des aspidistras. Ma mère avait beaucoup de plantes vertes à la maison qu’elle sortait au jardin, à l’ombre en été. Pas d’aspidistra. Ce sont des plantes de lieux malfamés. Je n’osais pas l’interroger davantage. Dans mon esprit d’enfant la proximité de l’évêché donnait un caractère rigoureux à ces lieux aussi le ton à la fois évasif et courroucé de ma mère embrouillait-il mes questions. Pourquoi le frère de Jacques descendait-il de ce quartier par une rue en escalier sur son scooter ? Quand nous l’avions croisé il avait l’air embarrassé et à la fois faisait le fanfaron, le visage rougi en nous voyant.
Mon goût pour les aspidistras a-t-il été lié au mystère persistant devant le ton péremptoire des réponses trop brèves de ma mère ? Comme perdue dans un décor d’ombre et de verdure où l’on chuchote dans les appartements de vieux châteaux poussiéreux aux tentures d’un rouge fané ou d’un vert émeraude pisseux dans une recherche indéfinie.
Jeune femme j’ai cherché à me procurer des aspidistras. Plante que l’on trouve difficilement. Quelle plante de concierge ! Disait une de mes tantes. Propos qui me renvoyait aussitôt l’image de ces trois maisons sombres aux volets à demi clos et de ces femmes qui attendaient. Ces trois maisons se situaient à côté du large et haut portail de l’évêché, mais ces dames ne pouvaient pas en être les concierges !
Cinquante ans plus tard je fais visiter la haute-ville à des amis. Je leur raconte les aspidistras, les dames peu vêtues, les chaussons aux pommes, les chaussettes de l’évêque et mes incompréhension naïves de l’époque. C’est alors que, se retirant légèrement du groupe, Louis, originaire du nord d’un département limitrophe, qui a circulé depuis son enfance dans cette ville ancienne se met à sourire. Arrêté devant les trois maisons noires aux volets disjoints, sans aspidistra, sans occupante il me montre par sa mimique qu’il saisit ou sait quelque chose qui me manque encore pour comprendre l’ensemble de cette vieille situation, devenue à nouveau présente. Je poursuis la visite guidée. Au lieu d’emprunter l’Escalier Boiteux je fais circuler mon groupe d’amis à travers d’autres rues, jusqu’aux vestiges d’une ancienne porte d’où nous grimpons au baptistère, passons sous le clocher et arrivons place du For. Deux bancs au pied de la croix. Nous nous y asseyons, le dos tourné au paysage. Devant nous le porche à trois marches est éclairé par un plein soleil ; le clocher, agencement savant de pierres volcaniques et de grès, touche le ciel.
C’est alors que Louis dont le talent de conteur nous captive souvent par des anecdotes judiciaires (il est magistrat), nous propose, pour que nous puissions nous reposer, de nous raconter l’histoire d’une jeune femme de sa famille qui a vécu rue du Cardinal de Polignac il y a soixante ans. Lui-même n’a pas de souvenir de cette personne. Enfant il avait remarqué que, lors des réunions de famille, dès que l’on prononçait son prénom –Rose – certains détournaient le regard ou baissaient la tête gênés.
Quand Louis avait tenté d’interroger sa mère à propos de Rose, s’étonnant qu’on ne la voie jamais et de l’effet produit par son seul prénom prononcé elle lui avait répondu : De toutes façons elle est partie, elle ne revient plus ici !
Avec patience, en consultant les photos de famille et en posant quelques questions au compte-gouttes il avait compris qu’elle était la fille de Baptiste, l’un des frères de sa grand-mère Berthe et qu’à la mort de sa propre mère elle était devenue fille de salle dans un restaurant d’une grande ville. Ses frères, plus âgés qu’elle, étaient restés à la ferme vivotant avec leur père d’une polyculture chiche qui les nourrissait mal.
Louis nous décrit une photo des années passées qu’il avait dénichée montrant une jeune femme de taille moyenne, les manches d’un corsage froncé relevées sur des bras dodus, un chignon s’écroulant sur la nuque, de petits cheveux encadrant un visage souriant, un regard posé sur le lointain.
La famille de Louis occupait trois maisons dans leur village d’origine. Lors de la mort de sa grand-mère Berthe, Louis a été mis à contribution pour déblayer l’une d’elles avant que l’une de ses sœurs vienne l’habiter aux vacances. Dans une malle coincée au fond d’un placard mural Louis a découvert de nombreux paquets de lettres rassemblées entre elles par un cordonnet de chanvre grossier.
Avec une forte envie de lire tout ce courrier et pour éviter que la découverte de ces lettres puisse embarrasser toute la famille, Louis emporte tout le contenu de la malle, prêts à consacrer un temps long à la lecture de ces correspondances. Il espère trouver cachée, jamais parlée, l’histoire de Rose. En gardant ce courrier que souhait donc la grand-mère Berthe ? Expliquer un parcours, des silences, des rejets ?
De ces lectures Louis déduit que Rose est une cousine germaine de Marthe, la mère de Louis. Berthe, la grand-mère de Louis et la mère de Rose était de la même génération. Rose, dernière de sa fratrie avait 10 ans à la naissance de Louis et 15 ans à la mort de sa mère. Elle écrit à ce moment là à son grand-oncle Julien pour lui dire qu’elle ne veut pas rester au village avec ses frères et son père, qu’elle veut gagner de l’argent en ville et vivre autrement. Le grand-oncle Julien après avoir lu la lettre de sa petite nièce l’expédie à sa sœur Berthe pour l’informer des souhaits de Rose. Ceci se passe dans les années 1960.
Après avoir été séminariste l’oncle Julien est devenu secrétaire de l’évêque ; en conséquence il est logé depuis plusieurs années dans les locaux de l’évêché, place du For. Lorsqu’il expédie à sa sœur Berthe la lettre que lui a envoyée Rose à la mort de sa mère il l’accompagne de quelques lignes mentionnant que sa fonction et son éloignement du village ne lui permettent pas d’aider Rose à trouver du travail, à quitter le village, son père et ses frères. Il s’interroge sur ce souhait de quitter les siens. Rose n’a que quinze ans.
Lors d’une fête patronale l’été suivant Rose se porte volontaire pour aider les patrons d’une auberge du village. Elle y est remarquée pour son ardeur au travail, sa présence souriante, la promptitude de son service. Son emploi se poursuit quelques mois à l’auberge.
Au printemps suivant Rose annonce à son père qu’elle a trouvé une meilleure place dans une brasserie célèbre à Lyon. Rose rend visite à sa grand-tante Berthe. Elle lui dit que rien ne la retient au village, surtout pas son père et ses frères qui vivent comme des pauvres et qu’elle ne veut pas d’un avenir de ce type. Pressée par Berthe Rose n’en dit pas davantage.
En conséquence Berthe tente une rencontre avec le père de Rose. Il se plaint que sa fille veuille partir loin et se réjouit à la fois d’avoir ainsi la perspective d’une bouche de moins à nourrir. C’est dans une lettre adressée à son frère Julien, dont Berthe a gardé le brouillon que Louis peut lire les éléments de ces étapes.
Au fil du temps la tante Berthe a pris soin d’écrire des feuillets datés qui retracent l’histoire de Rose depuis son départ du village. Rose, bien que cousine germaine de Marthe ( mère de Louis) ne semble pas avoir eu d’échanges avec elle. Important écart d’âge ? Attrait et confiance vers la grand-tante Berthe plus âgée ?
Rose a longtemps correspondu avec sa grand-tante Berthe et son grand-oncle Julien
Lors de la période d’emploi à Lyon on comprend que Rose est appréciée dans son travail par ses patrons. La brasserie se situe près de la gare. Beaucoup de client s’y rendent jusqu’à fort tard. Il n’y a pas de jour de fermeture hebdomadaire. Les années passent sans que Rose envisage de rendre visite à sa famille.
Alors qu’elle ne lui écrit jamais, Baptiste, père de Rose apprend par Berthe quelle est la vie de sa fille. Il comprend que son travail lui permet de vivre confortablement et même de faire des économies. Il souhaite que Julien et Berthe interviennent auprès de Rose afin qu’elle lui verse chaque année une part de ses économies. Julien et Berthe refusent de servir d’intermédiaires auprès de Rose et suggèrent à Baptiste de faire lui-même cette demande à sa fille.
A cette époque Pierre, père de Baptiste est encore en vie. Ancien maire du village il considère ce fils comme un raté. Prévenu par Berthe de la situation il se rend chez son fils. S’en suit une dispute violente que les murs de la ferme ont du mal à retenir. A l’issue de cette algarade Pierre et Baptiste ne se verront plus.
La ferme de Baptiste ne prospère pas. Ces hommes travaillent beaucoup mais n’entretiennent ni les outils, ni le matériel, ni les locaux. Les relations de voisinage sont difficiles avec eux. Ils ne parlent à personne, se lèvent tôt, se couchent tard, sont sales, fourbus. Les regarder gêne tout le monde au village.
Passent les années.
La tante Berthe et son époux (grands parents de Louis) décident d’organiser une grande fête de famille pour l’anniversaire de leurs cinquante ans de mariage. Ils veulent rassembler proches et plus éloignés dont Julien et Rose.
Rose n’adresse à sa tante et son oncle qu’une carte postale représentant un cœur et des roses où elle exprime brièvement qu’elle est retenue par son travail et qu’elle souhaite à tous une belle fête. L’oncle Julien, lui vient. Tout le monde voit l’absence de Rose et se tait.
Peu de temps avant cette invitation Julien a croisé Rose rue de Cardinal de Polignac. Ils se sont chaleureusement salués. Elle habite temporairement une petite maison sombre. Aux beaux jours, à travers les volets entre baillés on y voit des gros pots de plantes vertes aux feuilles souples et charnues et aussi des femmes souriantes et alanguies légèrement vêtues. Parmi elles : Rose. Je ne suis pas là tous les jours a-t-elle dit à Julien, seulement quand j’ai du temps libre.
L’oncle Julien va-t-il raconter cela à cette famille rassemblée ? C’est sur cette interrogation que Louis termine son histoire et nous reprenons la promenade. Un sourire entendu fleurit sur les lèvres de mes amis. Ce récit de Louis, offert à mes oreilles plus de cinquante ans après les goûters de chaussons aux pommes, s’il peint finement l’histoire de Rose ne dit rien du frère de Jacques. Pourquoi aller au bout de la rue du Cardinal de Polignac pouvait être une turpitude ? Lorsque Rose avait du temps libre… Une histoire sans chute que je n’ai pas comprise alors.
Ce n’est que quinze ans après cette promenade suivie du récit de Louis, au moment où j’écris cette histoire que je devine, que d’autres petites Rose qui avaient fuit leur village dans des conditions peut-être semblables ne vivaient dans ce rez-de-chaussée sombre, à l’ombre de l’évêché, ni pour les aspidistras ni pour les chaussons aux pommes et que des adultes pouvaient accuser en se fâchant très fort les grands garçons à scooter de faire dans leur maison des turpitudes.
Ckm Cap blanc octobre .2022