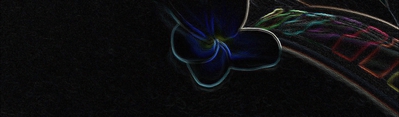http://aphanese.viabloga.com/news/lot-aout-22 lien vers les photos du séjour
Un pas après l’autre. Un mot après l’autre. Il y a entre la marche et l’écriture une résonnance, une reconnaissance, une amitié.
Je marche dans les rues de Paris. Pour aller d’un point A à un point B, mettons de mon travail Porte de Clignancourt à mon domicile au Père-Lachaise,
j’hésite souvent : quel chemin vais-je prendre ? J’en ai plusieurs et en invente d’autres sans cesse. J’aime marcher mais suivre la même voie
suscite en moi l’ennui. Alors je varie. Vais-je passer par la Place de Clichy, Saint-Lazare, Opéra, grands boulevards, République ?
Ou par le boulevard Barbès ? Rejoindrai-je l’Opéra par la Chaussée d’Antin ? Ou prendrai-je la voie qui mène rue du Poteau, rue Ramey,
rue de Chartres, rue Louis-Blanc avant de prendre le boulevard de Belleville ? Chaque chemin me donne à voir des espaces différents,
quartiers chics ou populaires, quartier grouillant de vie ou quartier calme de bureaux, tourbillon de couleurs et de saveurs immigrées ou torpeur provinciale. Je choisis, c’est selon mes humeurs, l’important est de ne pas se lasser, l’important est de marcher, de garder tout frais le plaisir de la marche.
Mais je ne marche pas qu’en ville. Il y a la montagne aussi. L’autre fois c’était dans les Pyrénées. La montagne est la variété portée à son extrême. Partir du refuge sur des flancs rocailleux couverts de pins odorants. Le chemin est poudreux entre les pierres et étouffe les pas. La montée est exténuante, on souffle comme pour raviver un feu, patience, un pas après l’autre, les pins se raréfient puis vous laissent continuer seuls dans une lande abrupte, toute droite vers le ciel. On s’arrête et se retourne, le vent glace votre sueur, on voit le chemin sinueux qu’on a suivi et le vaste paysage qu’on laisse derrière nous, le ciel et les nuages.
Arrive le col battu par le vent, et c’est la descente au milieu des éboulis, attention où mettre son pas, de grands blocs vous menacent de vous briser les os, c’est rude, le corps tout entier tremble sous l’amorti de chaque jambe, on est à la limite de la chute, mais dieu que c’est beau et qu’on est fier ! Plus bas, des broussailles puis de nouveau des pins, et des ravins où courent des ruisseaux et où s’allongent de longues fleurs violettes, tout un parterre vibrant qui tapisse les berges, des nuages s’amoncellent, le tonnerre gronde au loin, les falaises sont vertes où s’accrochent les arbres, des ronces vous agrippent parfois, puis ce sont des feuillus, de sombres forêts coupées de rus, moussues d’eau et d’ombres luisantes de chants d’oiseaux, et les falaises vertes qui partout vous observent. Le sac poisse, il est lourd à l’épaule, écrase le dos, mais on ne le sent pas.
On est dans le pas, on est dans son pas, on sait qu’on gardera tout ça, le voyage est le but.
Marc.B Cap Blanc août 2022
Je garais la voiture dans un silence total
le jardinier m’attendait sur le seuil de la maison ;
pas un pas de plus vers moi et nous partons directement faire le tour du jardin.
Observer ensemble les nouveautés de saison : les fleurs de l’oranger du Mexique sur lesquelles butinent tant d’abeilles et le jasmin Trachelospermum aux bouquets étoilés, autour de la porte d’entrée.
Sur la pergola s’enroulait l’Akébia Quinata aux fleurs bordeaux avec leur coeur de perles noires
Que de plaisir à partager le nom des plantes dont on se délectait.
Plus aucune notion du temps : une sorte de rêve, une harmonie heureuse, une complicité qui conduisaient nos pas au travers des allées de gravillons, de pierres, poteries cassées, herbes douces aux violettes, dans l’admiration de la mise en scène !
Le rosier Paul Himalaya dégoulinant du pin parasol, le camélia tardif qui avait échappé au gel et à la rouille de la pluie.
La pivoine arbustive s’ouvrant en kimono .
Dans le labyrinthe des allées rythmées de buis et haies variées, des surprises nous émouvaient : des mots écrits sur des ardoises, la sculpture du berbère-serpent de Wolfhart, celle d’Eva au bord de la piscine bien ronde et expressive.
le passage par la petite barrière en soulevant le voile sous les cornouillers
De quelle couleur la repeindre ?
Un peu trop d’ombre pour le rosier anglais qui mériterait une autre place
Le rosier Laure Davost explosait en arcade
le petit Banksia blanc démarrait doucement près des gaultéries, et des iris fanés ne restaient que le feuillage.
Puis c’était l’allée blanche aux hamammélis , le couvre sol d’hellébores déjà bien rétamés
C’était plutôt l’hiver que les blancs se déclinaient sur ces parterres là.
le saule tortueux s’étalait au dessus des pervenches
Et quand de retour à l’entrée, sous le chant des oiseaux, devant la façade aux roses « Ghislaine de Cunégonde », rose abricoté, je réalisais que le tour était fait, j’en demandais un second
Nous n’avions pas parcouru ensemble tous les recoins de ce paradis.
II
Ce jardin aux nombreuses haies , semblable à un labyrinthe pouvait paraître oppressant à certains visiteurs.
Comment s’y repérer sans le jardinier ?
Comment l’entretenir et gérer tous les arrosages nécessaires par cette canicule.
Envie de baisser les bras, l’abandonner pour le quitter.
Les hellébores ratatinées, les anémones du Japon séchées, les acanthes ramollies.
Tous ses signes de souffrance que je ne pouvais que constater, paralysée !
Sous la serre tout avait grillé et tant mieux !
Ouvrir et refermer la porte et les velux : je n’en étais plus capable, prisonnière de cet endroit sans vie
Toutes les espèces de menthe dans la mentheraie réclamaient de l’eau
les poires non récoltées s’écrasaient violemment sur les vitres de la serre et pourrissaient pleines de frelons et guêpes,
une vraie pataugeoire dans l’allée des figuiers: les figues écrabouillées au sol
Plus envie de confitures et figues séchées.
Plus envie de penser à cet avenir là.
Le petit pommier de Ste Germaine souffrait lui aussi,
ses fruits tombaient au bord de la piscine que plus personne n’utilisait.
La mise en route avait été laborieuse jusqu’à faire griller le moteur.
Quand les amis passaient on restait à l’intérieur au frais.
Le jardin n’était plus visitable : les dégâts trop visibles.
Désormais cachés sous les haies sauvages aux ronces démesurées, des sureaux démarraient,
les orties s’étalaient.
Dans les pots, sur la terrasse, le peu de terre était sec et dur à blesser les racines.
Envie d’y donner un coup de pied.
Les rosiers anciens persistaient, avec un peu de rouille, sans fleurs à cette période.
Entre résignation, lassitude et cruauté j’avais oublié ou refusais tous les gestes et rituels nécessaires au jardin
Je fis détruire la pergola
Laure Paris Cap Blanc août 2022

la photo comme un déroulé de pellicule
capter l'instant, l'instantané, la lumière, la balance des blancs
Imaginer entre deux prises, le mouvement andante qui va suivre
S'y plaire et attendre
anticiper la candeur, aller plus vite que la pensée, se laisser porter : attendre
photographier un nu sur une écorce fraîche
un tronc d'arbre à l'abandon d'une clairière
photographier une femme sur les cailloux d'une rivière
la voir se retourner
tout en elle est grâcieux, élégant
une calligraphie dansante
Rechercher un champ de maïs, un hors-champ, un plan d'ensemble
un cadre, une page
attendre qu'un vélo passe
écouter chaque bruit
entendre chaque pas
suivre les hirondelles
Savoir regarder et prendre le temps d'attendre
s'attarder sur la peau
un grain de beauté, une ride, une poitrine
le moindre geste fait sens
le moindre geste est signe
la porte entrouverte d'un cimetière sans église :
elle entre nue, ne peut pas reculer, avance
blasphème
et je capte
et je prends et je vole
toutes ses hésitations
tous ses balbutiements
ces mots qu'on ne dit pas et qui pourtant existent
dans l'entrelacs des âmes que l'on ne connaît pas
une croix, un calvaire
des noms gravés aussitôt oubliés
et puis ce corps de femme qui change à chaque pas
elle se baisse pour regarder par le la serrure vieille d'une porte de bois
et son corps se plie dans l'espace
elle ressemble à la poésie
elle ressemble à la vie
la Louise Labé de l'air
la vibrante insomnie
c'est elle ce corps que je dessine abstrait dans les courbes s'allongent
son corps se tend, il épouse le fer
il épouse le vent
il écoute le temps
elle a confiance en tout ce noir sur blanc
ces bribes de papier noirci
Femme libre …. j'écris ton nom !
Le débord
C’est un long, très long voyage celui de marcher sur le rebord d’un lit
où la poussière se mêle à l’empreinte du bord débordé.
Il y a les fleurs fanées près d’un bassin circulaire et les chaises esseulées et le bruit assourdis des voitures.
Et cette poussière qui enfle, occupe l’espace mentale de la femme abordée.
De la poussière sur sa peau. De la poussière dans ses cheveux.
Autour d’elle s’érigent des barrières de nuit. Il ne peut rien y faire.
Le débord du lit ne finira jamais d’en finir.
Sdel
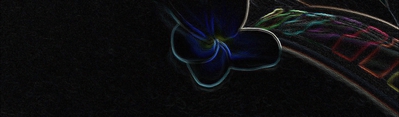 Sur la peau
Sur la peau
Une chambre bleue. Un rosier. Pas de fleur.
Une vague de sommeil pour un refuge silencieux.
Un drap de bain. Un verre de vin.
Le calme, la tempête.
S’aventurer dans la découverte des étoiles. Oublier leurs noms.
Se souvenir de
l’Ombre Bleutée
Sur la Peau
Tatouée
Sdel Cap Blanc août 2022
Hurler gueule ouverte. Hurler à la lune, au soleil, à tous les éléments. Hurler à la vie. Hurler à la mort.
Jusqu’à se casser la voix. Extraire de ce hurlement la moelle de vie qui couve, cachée sous une corde vocale fêlée.
Aller se tapir dans les grottes pour y déceler les grincements et s’agripper au calcaire froid. Rester là, longtemps, à écouter.
Un moment, l’envie vous vient de joindre votre hurlement à celui de votre vie passée et les deux sons se superposent.
Hurler en mineur, écouter en majeur et recouvrir ce bruit qui s’étire d’une stridence nouvelle.
Laisser les hurlements du vent s’engouffrer avec les hurlements de l’âme.
Hurler l’urgence, le presque parfait, le palpable et l’impalpable.
Hurler jusqu’à plus soif et hurler encore les jours de grand froid pour saisir sa vie à la vitesse des météores. Hurlement furtif qui s’ancre en nous comme un cri primal, bruit de tempête qui chaloupe notre ventre et fait bouillonner la soupe des cris.
Sons hurlés bien avant notre enfance, sous des générations lointaines qui nous cognent aux tempes et nous mènent aux confins de notre vie rêvée, dans les parcelles d’espaces striées par les vents planétaires.
Hurler jusqu’à ne plus dormir, jusqu’à trouver la sensation pure, mise sous la cloche de cristal, posée là, sur votre table de salon.
Hurler sans que personne ne vous suspecte de le faire. Car votre hurlement navigue seul, à l’intérieur de votre sternum. Il émet des vibrations que vous ne voulez pas lâcher. Il s’étale en secrets sur vos membres où il fait des taches, vous crée une géographie de tumeurs sur les bras, les jambes, la poitrine comme un chancre qui vous mange en silence.
Hurler encore et toujours pour atteindre l’inaccessible étoile qui vacille là-haut, si loin, indifférente à tout votre tohubohu.
Hurler jusqu’à se libérer du présent, vivre dans tous les temps à la fois et se faire un manteau pour vous protéger des agressions du futur.
Hurler en sonnant les cloches. Ca fait bing et ding et dang et dong. Mais ça ne vous suffit pas. En même temps, vous courez le long de la voie ferrée, vous marchez sur le bord de la falaise, vous pépiez d’impatience. Et tous les hurlements de votre vie se mettent à tourner dans un manège, il y en a même qui décollent des chaises volantes pour rejoindre les papillons.
Hurler au désastre de la terre, hurler dans un grand trou et enfouir ce cri jusqu’au cœur de l’univers comme un mantra, un remède à votre intranquillité.
Hurler au temps qui passe, saisir les minutes attrapées au lasso, les enrouler aux bornes de souvenirs sur votre passage et poursuivre votre chemin en vous bouchant les oreilles.
Evelyne Berson Cap Blanc août 2022